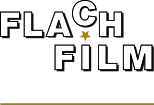Entretien avec Amira Casar, interprète de la Fille
J’ai toujours apprécié l’univers de Catherine Breillat. Son discours trouve un véritable écho en moi. Elle fait preuve d’une sorte de poésie mythique et mystique qui me touche. Lorsqu’elle m’a donné à lire ce scénario, une phrase m’a particulièrement marquée, mon personnage dit : « Je veux être regardée par là où je ne suis pas regardable ». Ces quelques mots ont suffit à déclencher mon imagination.
Mon parcours, ma formation classique m’ont sensibilisée aux grands textes. En l’occurrence, on trouve ici des mots riches de sens, de puissance, on sent La Maladie de la Mort de Marguerite Duras. J’y ai décelé un lien métaphorique avec la tragédie grecque. J’ai tout de suite comparé mon personnage à celui d’Ariane et à son ravissement – dans tous les sens du terme. J’y ai trouvé mon sous-texte, le secret de mon personnage. Rocco était Dionysos, venu pour ravir cette fille abandonnée par Thésée. Certains le considéreront comme Thésée, d’autres comme Bacchus. Personnellement, j’ai préféré un dieu à un playboy du Péloponnèse !
Catherine Breillat pose un regard particulier sur ses actrices. Elle les magnifie, elle les sublime. Lorsque nous nous sommes rencontrées la première fois, il y a eu communion entre son monde et mon imagination. Bien que le sujet soit violent et traité sans concession, bien que je sois pudique, sa démarche artistique m’a motivée. Elle a une vision extrêmement forte. Ce film est en quelque sorte l’anthologie de son univers. Cela m’a inspiré.
J’ai fait des films très différents. En 2003, j’ai particulièrement alterné les genres. Je suis arrivée sur Anatomie de l’enfer alors que je venais à peine d’achever le tournage de Ted and Sylvia de Christine Jeffs, avec entre autres Gwyneth Paltrow, l’histoire de poétesses dans le Londres d’après-guerre. Se
transporter dans le monde de Breillat marquait forcément une rupture. Mais j’y allais en confiance, prête à m’abandonner dans les limites claires que j’avais fixées. J’étais d’accord pour tout, sauf pour le live sex. J’ai donc obtenu une doublure. Et la limite de mon jeu est précisée dès le début du film.
A partir de là, j’ai pu me laisser filmer au plus près, servant le propos et la dimension de fable. L’homme et la fille n’ont pas de nom, ils sont les emblèmes d’une rencontre. Pour appuyer sa démarche, Catherine utilise des symboles, des métaphores, comme dans la tragédie ou la fable. Elle le fait de façon entière, honnête, avec la volonté de faire exploser les faux-semblants. Sa méthode échappe au vulgaire. Catherine dit souvent qu’il y a de l’obscurantisme dans notre monde puritain. En réaction, elle a cette démarche avant-gardiste. Elle fait preuve d’un véritable courage.
Mon personnage évolue dans une dimension qui dépasse l’anecdotique. Nous sommes dans une symbolique forte. J’incarne le genre féminin et ses interrogations, ses doutes. A travers ce rituel, cette fille accomplit un parcours. Chaque nuit marque une étape. Pour construire le personnage, je me suis servie du sous-texte d’Ariane, mais un autre élément m’a également inspirée. Depuis fort longtemps, je m’intéresse à Dora Maar et à Picasso et, à travers plusieurs expositions, j’ai retrouvé, dans la prolificité de son œuvre, mon fil rouge à moi, un dessin arraché d’un cahier, coloré à la cire : Dora et le Minotaure. Face à la créature, mi-homme mi-bête, Dora se tient en arrière, et dans son regard on peut lire à la fois
l’abandon le plus complet et une indomptabilité qui la rend maîtresse de son jeu. On reconnaît sa chevelure noire, ses ongles rouges et pointus – ceux-là mêmes que j’ai voulus pour mon personnage. Parfois, une image parle plus que les mots. C’est un double combat que j’ai retrouvé dans le film.
Certaines personnes vont penser que la fille est bafouée et ne vont pas comprendre le discours – féministe – de Catherine qui, pour libérer son héroïne, la fait passer par une auto-humiliation dont elle contrôle le processus. C’est elle qui choisit l’homme, elle le paye.
A une liberté. Pour moi, le film aborde le sacré et le profane. Catherine accomplit des allers-retours entre ces deux notions, révélant au passage la frontière entre les deux. Mon personnage se libère en allant vers une mort mythique qui transcende son parcours. Elle est comme un animal qui saurait qu’il va subir un sacrifice. Depuis le début, elle sent qu’elle va mourir. Elle se sacrifie elle-même à ce destin qu’elle va accomplir en quatre nuits et quatre jours. Dès les premières images du film, la notion de son sacrifice est là. C’est un des aspects les plus forts, l’opposition entre le sacrifiant et le sacrifié.
Nous venons d’univers extrêmement différents. Mais dans ce film, Rocco est un acteur et non un acteur de porno. Il a respecté mes limites et a toujours agi avec beaucoup de respect et d’élégance.
Catherine n’est pas dans la psychologie basique du comédien. J’ai souvent été émue par cette femme qui porte seule son fardeau contre vents et marées, qui arrive sur le plateau le matin et se retrouve dans le même émoi que l’acteur, parce qu’elle est dans le même labyrinthe, qu’elle ressent le même tremblement.
Elle devient une véritable partenaire de jeu. Les acteurs sont les extensions d’elle-même, de sa propre imagination, de son propos. Nous sommes la matière qu’elle pétrit. Elle est entière vis-à-vis de son œuvre. Elle ne se censure pas et, par son intelligence, vous entraîne dans sa pensée. Avec elle, on marche main dans la main dans le noir. Toute la richesse de sa culture repose sur un partage, un legs, qui m’inspirait énormément. J’espère toujours l’émotion. Quand j’adhère à l’univers d’un cinéaste, je peux aller très loin, même si je crois que je ne participerai à un tel projet qu’une seule fois dans ma vie. Catherine était consciente de mon extrême pudeur, de l’éducation protestante que j’ai reçue, et d’une rigueur qu’elle a appréciée. Je me suis mise à son service comme une femme volontaire et maîtresse de son destin, une femme qui partage sa pensée.
Ce sont des textes magnifiques qu’il ne fallait pas théâtraliser. Les césures sont complexes, les phrases longues, parfois discontinues, toujours signifiantes et d’un point de vue syntaxique, lourdes pour l’acteur. Tout cela est très fragile.
Entre le scénario de départ et l’image qui en est arrachée, il existe un monde.
Chaque jour, il faut créer l’image, et ce n’est pas une chose facile. Toute l’équipe doit rentrer dans un processus créatif parfois violent, impliquant, conflictuel par rapport à soi, par rapport à ses doutes, pour arriver à l’harmonie dont va naître l’image. Partir du néant pour créer une image et une pensée
chaque matin est une chose complètement abstraite. A mon sens, le travail de Catherine est comparable à celui d’un peintre.
Énormément. Je crois que je suis sortie de ce rôle à la fois vulnérable et extrêmement forte. Exercer le métier d’acteur de manière impliquée, avec un investissement profond, demande énormément d’énergie. Être nue sur un plateau n’est pas évident. Personnellement, je n’aime pas cela. Et en même temps, je me sentais extrêmement protégée par la deuxième peau que constituent le maquillage, la lumière. Tout cela participe à la dimension sublimée du film.
Nous ne travaillons pas les scènes ensemble. Elles naissent sur le plateau, dans l’instant. Il faut arriver en connaissant le texte sur le fil du rasoir car Catherine est capable de modifier chaque élément du contexte. Elle travaille dans le ressenti de l’instant. C’est ce qui arrive de moment en moment qui compte, pas ce qui est prévu, établi comme dans un storyboard.
Ce n’est pas non plus un travail d’improvisation car elle n’aime pas cela, mais un travail vivant, de l’instant qui, sans altérer le texte, peut en modifier le mouvement. En tant que comédien, on est donc constamment pétri. Catherine dirige incroyablement ses acteurs et j’aime beaucoup sa manière de le faire car on est à la fois extrêmement tenu et libre.
Le metteur en scène est là pour manipuler l’actrice. Si l’idée de cette manipulation rebute, c’est qu’il n’y a pas de confiance. Si je ne l’avais pas acceptée, j’aurais été à la mauvaise place. Anatomie de l’enfer peut choquer les esprits qui n’adhèreront pas au propos. Ce film n’était pas fait pour n’importe quelle actrice et nombre d’entre elles y seraient allées à reculons. Pour ma part, je considère Catherine
comme une avant-gardiste et je ne veux pas lui couper les ailes. Je l’ai laissée construire sa vision.
Lorsque l’on travaille avec quelqu’un comme Catherine, si on comprend son propos – non pas intellectuellement mais au plus profond de soi-même – on tend vers l’élévation.
Savez-vous quel souvenir vous garderez de cette expérience ?
Les choses ne sont pas figées. Ce n’est ni mon premier ni mon dernier film. Mais c’est une étape importante de ma vie d’actrice. Il compte beaucoup car j’y ai fait don de moi. Catherine aura été une rencontre. Elle est tout et son contraire. A la fois impudique et extrêmement pudique. A la fois violente et d’une extrême douceur. J’aime ce côté paradoxal. J’aime m’abandonner à son regard car je sais qu’il sublime l’actrice et la femme. Certains ne seront pas d’accord, mais c’est ma vision intime. Pour moi, elle est une héritière de Pasolini. Et si ce film choque, ce sera de la même façon que Salo car, avec un discours qui lui est propre, il est de cette lignée-là. Dans ma vie, même si mon éducation anglo-saxonne m’avait déjà donné un certain stoïcisme, Catherine m’a apporté quelque chose d’essentiel : le détachement.