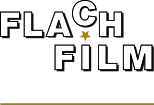Entretien avec Hervé Bourges et Jean-François Lepetit
Hervé Bourges avait été invité, dans le cadre d’Unifrance, par Daniel Toscan du Plantier, à une manifestation de promotion du cinéma français en Amérique Latine à laquelle je participais activement.
Je connaissais Hervé Bourges de longue date, d’abord comme fidèle soutien du cinéma français. Son livre « De Mémoire d’éléphant » venait de paraître, et il m’en offrit un exemplaire. Tout le monde connaît le Bourges patron de chaîne, président du CSA, et homme de médias. Mais j’ai découvert dans son livre un autre Bourges, acteur et témoin d’une partie de notre histoire collective…
Dans l’avion du retour, j’ai dévoré son livre, et notamment les chapitres consacrés à l’Algérie.
Arrivé à Roissy, je lui ai proposé de produire un documentaire sur ce thème, à savoir “son parcours algérien”. Il en a accepté le principe, mais il n’a réellement commencé à travailler sur ce projet qu’un an après son départ du CSA. Et nous avons produit ce film en 2002.
Hervé Bourges : J’ai été mobilisé, comme tous les jeunes Français de ma génération, et j’ai accompli mon service militaire en Algérie. Cela m’a permis de toucher du doigt la réalité de la société algérienne avant l’Indépendance, et de prendre la mesure du conflit qui se nouait. Je fus donc pendant trente mois, de janvier 1958 à l’été 1960, deuxième classe dans une unité de l’aviation légère de l’armée de terre, chargée du soutien opérationnel, et mes supérieurs hiérarchiques m’affectèrent d’emblée à des tâches d’organisation : le théâtre aux armées, l’encadrement des jeunes d’Aïn Arnat, ville voisine du camp. J’ai vu les contrastes entre convictions et comportements, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Un jugement sur cette période et sur le rôle de l’armée pendant cette période doit se garder de tout manichéisme et de toute simplification. C’est pourquoi je me suis toujours attaché à ne rien caricaturer. Je n’ai peut-être pas été exhaustif, comme devrait l’être un parfait historien, mais j’ai rendu compte de ce que j’ai vu, les bons et les mauvais côtés, de part et d’autre.
A votre retour, c’est une autre facette des événements que vous allez découvrir…
Hervé Bourges : A mon retour, je découvre l’action de l’Etat. Appelé au Cabinet d’Edmond Michelet, Garde des Sceaux, pour traiter les problèmes liés à l’Algérie, je me retrouve au centre d’un jeu de pouvoir compliqué où les barons du gaullisme, Michel Debré, Pierre Mesmer, tiennent une ligne dure, confrontée à l’évolution du Général de Gaulle lui-même, qui veut amener les esprits à une solution négociée. Là, je découvre une galerie de personnages remarquables et courageux : Edmond Michelet lui-même, Simone Veil, Germaine Tillion, Gisèle Halimi, mais aussi du côté des prisonniers algériens, Bachir Boumaza, par exemple, et les cinq chefs historiques détenus à l’Ile d’Aix, puis transférés à Turquant, Boudiaf, Aït Ahmed, Bitat, Khider, et surtout Ben Bella. C’est comme “geôlier” que je les rencontrerai régulièrement et que je serai leur intermédiaire officiel avec le gouvernement français, en la personne du Garde des Sceaux… J’ai eu alors une chance extraordinaire, celle de me trouver en coulisse, au milieu des acteurs, de pouvoir analyser leur jeu, d’aider à la recherche d’une solution pacifique.
Cette chance, vous l’aurez encore au lendemain des accords d’Evian ? Quel sera alors votre rôle ?
Hervé Bourges : C’est à l’été 1961 que Michel Debré obtient le départ d’Edmond Michelet de son gouvernement, et que je réintégre Témoignage Chrétien comme rédacteur en chef. C’est en tant que journaliste que je suis donc cette période, marquée à Paris par l’action du Préfet de Police Maurice Papon et en particulier par la répression sanglante des manifestations algériennes. Ensuite, les accords d’Evian ouvrent une période de désordres terribles en Algérie, avec un déchaînement de l’OAS qui joue le tout pour le tout, et la révélation des divergences profondes qui existent au sein du mouvement national algérien. De ce désordre émerge progressivement une force centralisatrice mieux organisée, le FLN, dont Ben Bella prend le contrôle en s’appuyant sur la force militaire que représente l’ALN dirigée par le colonel Boumediene. Sitôt installé à Alger, Ben Bella me demande d’apporter mon concours, au sein de son cabinet, à l’œuvre de construction institutionnelle et politique qu’il a devant lui. C’est un peu fou de ma part d’aller me mêler à cette partie, mais c’est en même temps exaltant… Et c’est ainsi que je serai encore un témoin direct et privilégié des premières années de la nouvelle République algérienne.
Quels sont les dossiers prioritaires dont vous vous occupez ?
Hervé Bourges : J’ai toujours tenté d’avoir une action cohérente avec mes convictions et ma formation : je me suis occupé de la prise en charge des jeunes, et de la préparation de la première génération de journalistes algériens, en faisant venir à Alger pour des sessions de formation de grands professionnels français… Autant que je le pouvais, je fus de ceux qui tentaient de maintenir des ponts entre les deux rives, malgré la violence de la séparation. C’est ainsi que j’ai été nommé directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire auprès d’un certain Abdelaziz Bouteflika, et que je suis devenu le collaborateur du ministre de la communication Bachir Boumaza, qui sera plus tard Président du Sénat algérien… Mais le tour pris par les événements, en particulier après le coup d’Etat du 19 juin 1965, quand Boumediene écarta Ben Bella du pouvoir, m’a conduit à quitter l’Algérie en 1967 pour revenir en France.
Retour facile ?
Hervé Bourges : Evidemment pas !… Mais c’est une autre histoire. Toujours est-il que je n’ai jamais cessé de suivre avec attention ce qui se passait de l’autre côté de la Méditerranée ! Même si j’y étais rarement retourné jusqu’à ce que les présidents Chirac et Bouteflika me confient la présidence de « Djazaïr, Une Année de l’Algérie en France » : plus de 2000 événements culturels, dans toute la France, qui nous permettent de renouer les fils d’un dialogue trop longtemps interrompu ! Je suis particulièrement heureux de m’employer ainsi à consolider les liens franco-algériens, comme je n’ai jamais cessé de le faire depuis cette époque !